
© Pixabay / Gerd Altmann
Au Moyen-Orient, qu’est-ce qui arrivera en premier : la réforme théologique ou la réforme politique ? Qu’est-ce qui compte le plus : le paradigme de la modernisation autoritaire ou le changement social par la base ? Les mouvements islamistes peuvent-ils s’intégrer pleinement dans le jeu démocratique ?
Ces questions, je les ai entendues pour la première fois quand j’ai commencé à étudier l’arabe, il y a 20 ans. Je les entends, identiques, aujourd’hui. Il y a toutefois un phénomène qui s’amorce, et qui pourrait les transformer au point de les rendre obsolètes, du moins dans leur formulation actuelle. Ce phénomène s’appelle la crise écologique.
Lire aussi : Pourquoi l'urgence climatique appelle à des efforts massifs dans les années 2020
Pour commencer à l’intégrer dans la perspective de recherche qui est celle d’Oasis, je me risque à formuler quelques réflexions, suscitées par des lectures, des rencontres, des observations personnelles.
Ces questions, je les ai entendues pour la première fois quand j’ai commencé à étudier l’arabe, il y a 20 ans. Je les entends, identiques, aujourd’hui. Il y a toutefois un phénomène qui s’amorce, et qui pourrait les transformer au point de les rendre obsolètes, du moins dans leur formulation actuelle. Ce phénomène s’appelle la crise écologique.
Lire aussi : Pourquoi l'urgence climatique appelle à des efforts massifs dans les années 2020
Pour commencer à l’intégrer dans la perspective de recherche qui est celle d’Oasis, je me risque à formuler quelques réflexions, suscitées par des lectures, des rencontres, des observations personnelles.
I. La destruction de l’environnement au Moyen-Orient
1. La crise écologique
Le concept de crise écologique dépasse le phénomène de réchauffement global qui fait aujourd’hui la une de la presse. Il désigne la destruction du milieu naturel du fait d’une exploitation excessive, d’une mauvaise gestion, de comportements irresponsables, de guerres et de conflits. Réduction des ressources hydriques, désertification, bétonnage sans limites, invasion des déchets sont parmi ses manifestations les plus communes.
Le réchauffement global est un aspect de la crise écologique. Il s’agit d’un fait objectif, observé en toute certitude par les scientifiques. Il comprend un élément naturel dépendant des oscillations climatiques, et un élément lié à l’activité de l’homme, qu’on estime être devenu prépondérant. (1) Il reste encore difficile d’avancer des prévisions crédibles sur ses effets à long terme : combien exactement augmentera la température globale, et quelles conséquences entraînera-t-elle ? Quelle sera la hausse du niveau de la mer ? Isoler le réchauffement global de la crise écologique plus vaste dans lequel il s’inscrit risque de produire paradoxalement des effets de distorsion, par exemple en concentrant toutes les ressources – nécessairement limitées – sur la modernisation du mode de production des économies avancées et en oubliant les problèmes propres aux pays moins développés.
La première thèse que je voudrais avancer est très simple : même si le réchauffement global devait soudainement s’arrêter, démentant tous les modèles de prévisions, le Moyen-Orient est déjà au bord de l’effondrement écologique, et cela ne pourra qu’avoir des effets énormes sur les sociétés européennes.
Le réchauffement global est un aspect de la crise écologique. Il s’agit d’un fait objectif, observé en toute certitude par les scientifiques. Il comprend un élément naturel dépendant des oscillations climatiques, et un élément lié à l’activité de l’homme, qu’on estime être devenu prépondérant. (1) Il reste encore difficile d’avancer des prévisions crédibles sur ses effets à long terme : combien exactement augmentera la température globale, et quelles conséquences entraînera-t-elle ? Quelle sera la hausse du niveau de la mer ? Isoler le réchauffement global de la crise écologique plus vaste dans lequel il s’inscrit risque de produire paradoxalement des effets de distorsion, par exemple en concentrant toutes les ressources – nécessairement limitées – sur la modernisation du mode de production des économies avancées et en oubliant les problèmes propres aux pays moins développés.
La première thèse que je voudrais avancer est très simple : même si le réchauffement global devait soudainement s’arrêter, démentant tous les modèles de prévisions, le Moyen-Orient est déjà au bord de l’effondrement écologique, et cela ne pourra qu’avoir des effets énormes sur les sociétés européennes.
Personnellement, j’ai commencé à prendre conscience de la portée du phénomène en 2008, pendant un séjour d’été à Damas. (…) Un fleuve, le Barada, que Naaman le Syrien disait être « meilleur que toutes les eaux d’Israël » (2R 5,12), réduit à un ruisseau malodorant ; l’oasis complètement engloutie par le ciment ; des problèmes constants d’approvisionnement hydrique. Et il n’est guère difficile d’imaginer que huit années de guerre aient aggravé encore la crise.
Ce qui restait de l’ancienne Damas, c’étaient les monuments, surtout les mosaïques de la mosquée omeyyade, mais sans leur contexte, sans le paysage dans lequel ils avaient été conçus. La même sensation déchirante, je l’ai vécue à Ispahan, un peu plus tard. En plein hiver, le fleuve Zayandeh était presque complètement à sec : il ne restait qu’un peu d’eau stagnante au-dessous du spectaculaire Pont Khadjou. Fleurs, plantes et jardins décoraient encore les majoliques des mosquées, mais comme dans un univers maniériste, leurs référents naturels avaient disparu. Il n’en restait que le simulacre symbolique.
Ces deux expériences traumatisantes m’ont incité à relier tant de points dispersés en un unique dessin : j’ai revu les pentes du Liban de plus en plus urbanisées, le Jourdain inexistant à la hauteur du site du Baptême de Jésus en Jordanie, la Mer Morte coupée en deux, les puits asséchés de Palmyre, les palmiers d’Erbil que l’on couvre l’été avec des parasols afin qu’ils résistent à l’embrasement solaire, et puis la sécheresse syrienne, qui fut l’une des causes de la révolte de 2011, la crise des ordures à Beyrouth alimentée par le flux des réfugiés, les incendies spontanés dans les champs en Tunisie, et, hors du Moyen-Orient, le Lac Tchad qui, de 1963 à aujourd’hui, a perdu les trois quarts de sa superficie...
Le coup de grâce, pour ainsi dire, je l’ai reçu il y a un an, en revenant au Caire. (…) J’étais préparé, pour l’avoir lu dans la presse, aux nouvelles cités-satellites qui, du Caire, s’allongent à perte de vue vers Suez. Mais ce qui a dépassé mon imagination, ce sont les 70 kilomètres de la côte de ‘Ayn Sokhna à Zaafarana qui, de désert, s’étaient transformés en une suite ininterrompue de fillāt, « villas » : rangées de maisons mitoyennes, construites pour la bourgeoisie du Caire qui y cherche un refuge (illusoire) contre la chaleur estivale. La plupart des villas n’étaient pas terminées, et beaucoup ne le seront jamais parce que les projets étaient surdimensionnés. Le désastre environnemental, toutefois, était consommé.
Si ces instantanées peuvent apparaître improvisées, encore que de première main, d’autres cas ont été étudiés à fond. Peter Harling, fondateur de Synaps Network, a consacré un rapport approfondi (...) à la crise hydrique en Iraq, (3) symbolisée par Bassora, la ville de plus de 2 millions d’habitants, située un peu en aval de la confluence entre le Tigre et l’Euphrate. Ce qui fut le port de Sindbad le marin est aujourd’hui un enfer où les températures l’été arrivent à 50 degrés (le record est de 53,9 degrés en 2016). Dans cette situation, pouvoir disposer d’eau potable est une question vitale, mais à Bassora, le Tigre et l’Euphrate – déplore un expert irakien en pollution de l’eau – « ne sont même plus des fleuves : ce sont des fosses septiques mobiles ».
Le gouvernement en blâme l’Iran voisin, qui, frappé par la sécheresse, a barré les affluents du Tigre : il en aspire l’eau, et décharge, dans les lits tristement vides des fleuves, des eaux d’égout, qui se déversent ainsi du haut plateau iranien sur l’ancienne Mésopotamie. Mais, selon Harling, les responsabilités les plus lourdes sont locales. « Chaque jour, l’Irakien moyen consomme 392 litres d’eau à des fins domestiques seulement, soit près du double de la moyenne internationale de 200 litres, selon un fonctionnaire de l’Unicef basé à Bagdad. Cette quantité exorbitante coûte aux résidents le prix incroyablement bas de 1,4 dollar (1,27 euro) par an, en supposant même qu’ils paient leurs factures, ce qui est peu fréquent. » (3) Seuls 14 des 252 centres urbains irakiens traitent leurs eaux usées mais, dans une telle situation, « la classe dirigeante s’adonne à la chasse au bouc émissaire, ou à la pensée magique », par exemple en proposant d’amener un iceberg du Pôle Sud (4).
Ce qui restait de l’ancienne Damas, c’étaient les monuments, surtout les mosaïques de la mosquée omeyyade, mais sans leur contexte, sans le paysage dans lequel ils avaient été conçus. La même sensation déchirante, je l’ai vécue à Ispahan, un peu plus tard. En plein hiver, le fleuve Zayandeh était presque complètement à sec : il ne restait qu’un peu d’eau stagnante au-dessous du spectaculaire Pont Khadjou. Fleurs, plantes et jardins décoraient encore les majoliques des mosquées, mais comme dans un univers maniériste, leurs référents naturels avaient disparu. Il n’en restait que le simulacre symbolique.
Ces deux expériences traumatisantes m’ont incité à relier tant de points dispersés en un unique dessin : j’ai revu les pentes du Liban de plus en plus urbanisées, le Jourdain inexistant à la hauteur du site du Baptême de Jésus en Jordanie, la Mer Morte coupée en deux, les puits asséchés de Palmyre, les palmiers d’Erbil que l’on couvre l’été avec des parasols afin qu’ils résistent à l’embrasement solaire, et puis la sécheresse syrienne, qui fut l’une des causes de la révolte de 2011, la crise des ordures à Beyrouth alimentée par le flux des réfugiés, les incendies spontanés dans les champs en Tunisie, et, hors du Moyen-Orient, le Lac Tchad qui, de 1963 à aujourd’hui, a perdu les trois quarts de sa superficie...
Le coup de grâce, pour ainsi dire, je l’ai reçu il y a un an, en revenant au Caire. (…) J’étais préparé, pour l’avoir lu dans la presse, aux nouvelles cités-satellites qui, du Caire, s’allongent à perte de vue vers Suez. Mais ce qui a dépassé mon imagination, ce sont les 70 kilomètres de la côte de ‘Ayn Sokhna à Zaafarana qui, de désert, s’étaient transformés en une suite ininterrompue de fillāt, « villas » : rangées de maisons mitoyennes, construites pour la bourgeoisie du Caire qui y cherche un refuge (illusoire) contre la chaleur estivale. La plupart des villas n’étaient pas terminées, et beaucoup ne le seront jamais parce que les projets étaient surdimensionnés. Le désastre environnemental, toutefois, était consommé.
Si ces instantanées peuvent apparaître improvisées, encore que de première main, d’autres cas ont été étudiés à fond. Peter Harling, fondateur de Synaps Network, a consacré un rapport approfondi (...) à la crise hydrique en Iraq, (3) symbolisée par Bassora, la ville de plus de 2 millions d’habitants, située un peu en aval de la confluence entre le Tigre et l’Euphrate. Ce qui fut le port de Sindbad le marin est aujourd’hui un enfer où les températures l’été arrivent à 50 degrés (le record est de 53,9 degrés en 2016). Dans cette situation, pouvoir disposer d’eau potable est une question vitale, mais à Bassora, le Tigre et l’Euphrate – déplore un expert irakien en pollution de l’eau – « ne sont même plus des fleuves : ce sont des fosses septiques mobiles ».
Le gouvernement en blâme l’Iran voisin, qui, frappé par la sécheresse, a barré les affluents du Tigre : il en aspire l’eau, et décharge, dans les lits tristement vides des fleuves, des eaux d’égout, qui se déversent ainsi du haut plateau iranien sur l’ancienne Mésopotamie. Mais, selon Harling, les responsabilités les plus lourdes sont locales. « Chaque jour, l’Irakien moyen consomme 392 litres d’eau à des fins domestiques seulement, soit près du double de la moyenne internationale de 200 litres, selon un fonctionnaire de l’Unicef basé à Bagdad. Cette quantité exorbitante coûte aux résidents le prix incroyablement bas de 1,4 dollar (1,27 euro) par an, en supposant même qu’ils paient leurs factures, ce qui est peu fréquent. » (3) Seuls 14 des 252 centres urbains irakiens traitent leurs eaux usées mais, dans une telle situation, « la classe dirigeante s’adonne à la chasse au bouc émissaire, ou à la pensée magique », par exemple en proposant d’amener un iceberg du Pôle Sud (4).

L'Euphrate en 2006 (au-dessus) et en 2009 (en dessous) © NASA
Durant l’été 2018, une épidémie de choléra a éclaté à Basra, expédiant plus de 100 000 personnes à l’hôpital. Dans le même temps, l’Iran a temporairement coupé ses fournitures d’énergie électrique, pour des raisons économiques et comme forme de pression politique. On est arrivé ainsi au paradoxe de 2 millions de personnes assises sur l’un des plus grands gisements de pétrole du monde, en proie à une épidémie de choléra, sans eau, sans électricité et, partant, sans climatiseurs, avec une température externe de 50 degrés.
Le plus surprenant, ce n’est pas qu’une révolte ait éclaté, mais qu’il ait été possible de la maîtriser. Devant des cas-limites de ce genre, on comprend mieux ce que j’ai affirmé au début : pour l’habitant moyen de Basra, des catégories comme nouvelle constitution irakienne, réforme du discours religieux, wilāyat al-faqīh, etc. ne présentent aucun intérêt. En réalité, elles sont bien pertinentes, dans la mesure où la possibilité de porter remède au désastre dépend aussi de la capacité d’invertir des politiques erronées et de faire barrage à la corruption déferlante. Mais il est difficile de garder la lucidité nécessaire pour s’en rendre compte.
Il est vrai, tous les États du Moyen-Orient ne connaissent pas de crises de la portée de celle qui a investi l’Iraq ou le Yémen, ce dernier lancé, dès avant la guerre, vers le primat peu enviable de première nation au monde à rester sans eau. Mais même là où les choses vont mieux, comme au Maroc, une grande partie des ressources sont utilisées pour l’agriculture industrielle, tournée elle-même vers l’exportation, comme l’ont montré les contestations qui ont explosé en 2017 à Zagora (5) ; et les nouvelles maxi-centrales solaires ne vont pas résoudre nécessairement tous les problèmes environnementaux. (6)
Le plus surprenant, ce n’est pas qu’une révolte ait éclaté, mais qu’il ait été possible de la maîtriser. Devant des cas-limites de ce genre, on comprend mieux ce que j’ai affirmé au début : pour l’habitant moyen de Basra, des catégories comme nouvelle constitution irakienne, réforme du discours religieux, wilāyat al-faqīh, etc. ne présentent aucun intérêt. En réalité, elles sont bien pertinentes, dans la mesure où la possibilité de porter remède au désastre dépend aussi de la capacité d’invertir des politiques erronées et de faire barrage à la corruption déferlante. Mais il est difficile de garder la lucidité nécessaire pour s’en rendre compte.
Il est vrai, tous les États du Moyen-Orient ne connaissent pas de crises de la portée de celle qui a investi l’Iraq ou le Yémen, ce dernier lancé, dès avant la guerre, vers le primat peu enviable de première nation au monde à rester sans eau. Mais même là où les choses vont mieux, comme au Maroc, une grande partie des ressources sont utilisées pour l’agriculture industrielle, tournée elle-même vers l’exportation, comme l’ont montré les contestations qui ont explosé en 2017 à Zagora (5) ; et les nouvelles maxi-centrales solaires ne vont pas résoudre nécessairement tous les problèmes environnementaux. (6)
2. Une nouvelle forme de civilisation islamique
La portée de ces changements environnementaux est énorme. Dans bien des régions du Moyen-Orient, le gaspillage des ressources naturelles, la pression anthropique, le réchauffement global qui s’est déjà produit, donc sans compter le réchauffement futur, ont décrété la mort de la forme classique de la civilisation islamique, fondée sur l’alternance dialectique entre désert, cité et zones cultivées : sur le plan climatique, social, et même architectonique.
Un changement de forme, en soi, n’est pas nécessairement négatif, bien au contraire. Après tout, si une civilisation est vivante, elle change continuellement d’aspect, comme un organisme qui se renouvelle. Les villes italiennes en sont une preuve éclatante, avec leur mélange de styles différents. Mais si la nouvelle forme est le gratte-ciel dévoreur d’énergie dans le style du Golfe, dans une bulle d’air climatisé d’où ne sortent pendant les mois d’été que les « esclaves » (pour citer l’ouverture d’un vieux reportage d’Oasis), alors, il vaut la peine de se poser une question. (7) Un tel modèle est-il soutenable ?
Bien que l’idée ait du mal à se frayer un chemin dans les études, souvent répétitives, sur l’impact de la modernité sur le monde islamique, les effets de ce changement de forme se font sentir nettement même sur le plan religieux. Il suffit de penser à la portée symbolique d’une Mecca Tower (techniquement Abraj al-Bayt), le gratte-ciel gigantesque à deux pas du lieu le plus sacré de l’Islam, quatrième édifice le plus haut du monde, en partie hôtel cinq étoiles, en partie centre commercial, avec deux héliports et 96 ascenseurs, devant lequel la Kaaba voisine s’efface littéralement. Pas besoin d’être Jacques Le Goff pour comprendre que l’horloge qui en orne les façades – la plus grande du monde – se partage au moins également entre le temps de Dieu et le temps du marchand.
S’il en est ainsi dans le Moyen-Orient financièrement aisé, bénéficiaire des revenus du pétrole et du gaz et – du moins dans le Golfe – administré avec clairvoyance, on peut se demander à plus forte raison ce que cela signifie que de naître et être socialisé dans un bidonville où l’eau arrive une fois par mois. Quelle différence y a-t-il entre lire le Coran dans une communauté rurale, dans une mégapole ou dans une Sahara-town ? Quel sentiment de soi peut susciter l’expérience d’avoir les parasites dans le ventre et le téléphone portable dans la poche ? Il ne s’agit pas évidemment de retourner à la vieille dialectique marxiste structure-superstructure et à son sombre déterminisme, mais bien de prendre au sérieux la polarité anthropologique corps-âme.
Un changement de forme, en soi, n’est pas nécessairement négatif, bien au contraire. Après tout, si une civilisation est vivante, elle change continuellement d’aspect, comme un organisme qui se renouvelle. Les villes italiennes en sont une preuve éclatante, avec leur mélange de styles différents. Mais si la nouvelle forme est le gratte-ciel dévoreur d’énergie dans le style du Golfe, dans une bulle d’air climatisé d’où ne sortent pendant les mois d’été que les « esclaves » (pour citer l’ouverture d’un vieux reportage d’Oasis), alors, il vaut la peine de se poser une question. (7) Un tel modèle est-il soutenable ?
Bien que l’idée ait du mal à se frayer un chemin dans les études, souvent répétitives, sur l’impact de la modernité sur le monde islamique, les effets de ce changement de forme se font sentir nettement même sur le plan religieux. Il suffit de penser à la portée symbolique d’une Mecca Tower (techniquement Abraj al-Bayt), le gratte-ciel gigantesque à deux pas du lieu le plus sacré de l’Islam, quatrième édifice le plus haut du monde, en partie hôtel cinq étoiles, en partie centre commercial, avec deux héliports et 96 ascenseurs, devant lequel la Kaaba voisine s’efface littéralement. Pas besoin d’être Jacques Le Goff pour comprendre que l’horloge qui en orne les façades – la plus grande du monde – se partage au moins également entre le temps de Dieu et le temps du marchand.
S’il en est ainsi dans le Moyen-Orient financièrement aisé, bénéficiaire des revenus du pétrole et du gaz et – du moins dans le Golfe – administré avec clairvoyance, on peut se demander à plus forte raison ce que cela signifie que de naître et être socialisé dans un bidonville où l’eau arrive une fois par mois. Quelle différence y a-t-il entre lire le Coran dans une communauté rurale, dans une mégapole ou dans une Sahara-town ? Quel sentiment de soi peut susciter l’expérience d’avoir les parasites dans le ventre et le téléphone portable dans la poche ? Il ne s’agit pas évidemment de retourner à la vieille dialectique marxiste structure-superstructure et à son sombre déterminisme, mais bien de prendre au sérieux la polarité anthropologique corps-âme.
3. Le réchauffement global
Voilà, à grands traits, le présent de la crise écologique au Moyen-Orient. Faisons maintenant l’exercice d’y ajouter un modeste réchauffement global, un degré par exemple. C’est très peu en regard des modèles qui circulent, et la plupart des climatologues considérerait une prévision de cette portée à la limite du négationnisme. Mais que signifie un degré de plus ?

Entre le 5 et le 15 avril 1815, le volcan de Tambora, dans l’Indonésie actuelle, fut secoué par une très violente éruption, qui le fit passer de plus de 4 000 m d’altitude aux 2 850 actuels. La catastrophe, qui avait atteint, estime-t-on, le niveau 7 de l’échelle VEI (Volcanic Explosivity Index), juste un degré au-dessous du maximum, entraîna une baisse de la température mondiale estimée de 0,5 à 1 degré centigrade, à cause des cendres dispersées dans l’atmosphère.
Parmi les effets les plus curieux de l’éruption, il y eut la naissance du personnage de Frankenstein : les tempêtes de neige continuelles – 1816 fut appelé « l’année sans été » – obligèrent Mary Shelley à rester enfermée dans la maison qu’elle avait louée avec des amis dans les Alpes suisses. On soutient également que l’invention du vélocipède, ancêtre de la bicyclette, fut stimulée par l’absence d’animaux de trait due à la carence de fourrage. Parmi les effets moins agréables, il y eut la mort de près de 200 000 personnes en Europe, une épidémie de choléra à travers toute l’Asie, et une migration historique partie de la Nouvelle-Angleterre, qui signa le début de l’occupation massive des territoires du Midwest.
Des bouleversements de cet ordre ont laissé des traces profondes également dans les phases les plus reculées de l’histoire de l’humanité. Nicola Di Cosmo, de l’Institute for Advanced Study de Princeton, se consacre par exemple depuis quelques années à l’étude des effets des oscillations climatiques sur les nomades des steppes d’Asie, dans une perspective intégrée. (8) Leurs déplacements, par exemple, provoquèrent au IIIe siècle la crise quasi contemporaine de l’empire romain et l’écroulement de la dynastie chinoise Han. (…) Évidemment, dans ce genre de recherches, on court toujours le risque de tomber dans le déterminisme (…). Mais faisant abstraction des exagérations, les données du contexte environnemental constituent un élément important, encore que difficile à mesurer, pour comprendre l’évolution des civilisations.
Laissons de côté le cas de la dynastie Han, dont les technologies ne sont certes pas comparables aux nôtres, ou encore l’impact sur l’Europe de l’optimum climaticum médiéval, et réfléchissons un instant sur les événements du début du XIXe siècle. Si un degré, momentané, de différence en 1815, déjà en pleine révolution industrielle, fut suffisant pour déclencher une véritable « crise de subsistance dans le monde occidental », (9) quels effets aurait un changement analogue – et nous faisons déjà une prévision bien optimiste – sur des régions éprouvées comme le Moyen-Orient et le Sahel ?
Parmi les effets les plus curieux de l’éruption, il y eut la naissance du personnage de Frankenstein : les tempêtes de neige continuelles – 1816 fut appelé « l’année sans été » – obligèrent Mary Shelley à rester enfermée dans la maison qu’elle avait louée avec des amis dans les Alpes suisses. On soutient également que l’invention du vélocipède, ancêtre de la bicyclette, fut stimulée par l’absence d’animaux de trait due à la carence de fourrage. Parmi les effets moins agréables, il y eut la mort de près de 200 000 personnes en Europe, une épidémie de choléra à travers toute l’Asie, et une migration historique partie de la Nouvelle-Angleterre, qui signa le début de l’occupation massive des territoires du Midwest.
Des bouleversements de cet ordre ont laissé des traces profondes également dans les phases les plus reculées de l’histoire de l’humanité. Nicola Di Cosmo, de l’Institute for Advanced Study de Princeton, se consacre par exemple depuis quelques années à l’étude des effets des oscillations climatiques sur les nomades des steppes d’Asie, dans une perspective intégrée. (8) Leurs déplacements, par exemple, provoquèrent au IIIe siècle la crise quasi contemporaine de l’empire romain et l’écroulement de la dynastie chinoise Han. (…) Évidemment, dans ce genre de recherches, on court toujours le risque de tomber dans le déterminisme (…). Mais faisant abstraction des exagérations, les données du contexte environnemental constituent un élément important, encore que difficile à mesurer, pour comprendre l’évolution des civilisations.
Laissons de côté le cas de la dynastie Han, dont les technologies ne sont certes pas comparables aux nôtres, ou encore l’impact sur l’Europe de l’optimum climaticum médiéval, et réfléchissons un instant sur les événements du début du XIXe siècle. Si un degré, momentané, de différence en 1815, déjà en pleine révolution industrielle, fut suffisant pour déclencher une véritable « crise de subsistance dans le monde occidental », (9) quels effets aurait un changement analogue – et nous faisons déjà une prévision bien optimiste – sur des régions éprouvées comme le Moyen-Orient et le Sahel ?
4. L’impact sur l’Europe
Contrairement aux idées reçues, l’homme, généralement, n’aime pas se déplacer et tend à rester dans l’endroit où il est né, même quand les circonstances lui conseilleraient de partir. Sinon, on ne s’expliquerait pas la persistance de métropoles en des lieux, comme les sites actuels de Damas ou de Sanaa, qui n’en justifient plus l’existence. Et pourtant, il y a une limite à toute chose : au-delà d’un certain point, la migration devient une question de vie ou de mort.
Les effets sur l’Europe des migrations climatiques, déjà en cours, seront amplifiés par le déséquilibre démographique entre l’explosion de la population au Moyen-Orient et en Afrique, et la chute des naissances qui caractérise notre continent, et l’Italie tout particulièrement.
Une simple donnée anecdotique. Quand je me suis rendu pour la première fois en Égypte, en 2001, il y avait 60 millions d’habitants, comme en Italie. Aujourd’hui, l’Italie en a toujours 60 millions, l’Égypte, 100 : une croissance impétueuse qui a absorbé tout progrès économique. Mais si la population augmente, l’eau du Nil, elle, reste la même – ou plutôt elle se réduit, parce qu’entretemps, l’Éthiopie, où le Nil Bleu prend sa source, a atteint elle aussi les 100 millions d’habitants. Le résultat net est que, au Caire, en moyenne, on vit plus mal.
Jusqu’à présent, la différence de potentiel n’a pas déclenché une migration de masse, mais que se passerait-il si 5 millions d’Égyptiens – pas plus du 5 % du total – décidaient de quitter leur pays ? Les migrations, dans ces proportions, constituent un problème. Il ne peut pas être résolu en le niant. Tout simplement une société formée en très grande majorité de personnes âgées n’a pas les moyens, ne serait-ce que psychologiques, pour y faire face.
Les effets sur l’Europe des migrations climatiques, déjà en cours, seront amplifiés par le déséquilibre démographique entre l’explosion de la population au Moyen-Orient et en Afrique, et la chute des naissances qui caractérise notre continent, et l’Italie tout particulièrement.
Une simple donnée anecdotique. Quand je me suis rendu pour la première fois en Égypte, en 2001, il y avait 60 millions d’habitants, comme en Italie. Aujourd’hui, l’Italie en a toujours 60 millions, l’Égypte, 100 : une croissance impétueuse qui a absorbé tout progrès économique. Mais si la population augmente, l’eau du Nil, elle, reste la même – ou plutôt elle se réduit, parce qu’entretemps, l’Éthiopie, où le Nil Bleu prend sa source, a atteint elle aussi les 100 millions d’habitants. Le résultat net est que, au Caire, en moyenne, on vit plus mal.
Jusqu’à présent, la différence de potentiel n’a pas déclenché une migration de masse, mais que se passerait-il si 5 millions d’Égyptiens – pas plus du 5 % du total – décidaient de quitter leur pays ? Les migrations, dans ces proportions, constituent un problème. Il ne peut pas être résolu en le niant. Tout simplement une société formée en très grande majorité de personnes âgées n’a pas les moyens, ne serait-ce que psychologiques, pour y faire face.
5. Scénarios pour l’avenir
Le modèle capitaliste qui s’est imposé au niveau mondial semble avoir besoin d’une frontière en retraite perpétuelle. Et fort logiquement, certains commencent aujourd’hui à rêver de voyages dans l’espace qui puissent permettre de coloniser quelque nouvelle planète, Mars à l’occurrence. Le cas échéant, point ne serait besoin de modifier quoi que ce soit : l’homme devrait tout simplement s’habituer à l’idée d’un « saut de planète » chaque fois que les ressources commencent à manquer. Mais comme ce scénario est hautement improbable, pour ne pas dire pure science-fiction, la crise écologique imposera de modifier le système économique en vigueur. Et c’est là, en un certain sens, la bonne nouvelle.
Le risque en cela est de céder à des pulsions antimodernes qui ne seraient d’aucun secours pour résoudre le problème. En d’autres termes, au niveau actuel de la population mondiale, un retour au monde « d’avant les machines » n’aurait pas l’effet utopique de nous restituer à un environnement incontaminé, mais de nous condamner à mourir de faim. Il est clair qu’une bonne partie du problème tourne autour de la possibilité de produire de l’énergie non polluante. Et sur ce point, la confusion règne, souveraine.
À titre d’exemple, le nouveau mantra des automobiles électriques ne comporte aucun bénéfice de fond, si l’électricité est produite en brûlant du charbon. Il déplace seulement le problème, en l’empirant. Plutôt que les actuelles énergies renouvelables, qui pourront difficilement couvrir tous les besoins énergétiques, le pari sur la longue période semble concerner la fusion nucléaire. Une révolution dans ce domaine rendrait d’un seul coup obsolètes les formes d’énergie actuelles. Pour un pays comme l’Italie, pauvre en matières premières et qui n’a par conséquent rien à perdre, ce devrait être la priorité absolue sur laquelle concentrer la recherche.
Mais le scénario optimiste de l’énergie propre n’est pas le seul. Il y en a un autre : le rythme des innovations technologiques ne permet pas un accès immédiat à de nouvelles formes d’énergie. Le système économique se modifie trop lentement, du fait de l’incapacité des individus et des États à faire passer le bien universel avant leur propre intérêt immédiat ; du fait, aussi, de la difficulté, y compris psychologique et cognitive, à penser des problèmes complexes comme le changement climatique, et à modifier en conséquence ses propres habitudes, surtout quand elles semblent encore soutenables. La croissance démographique continue bien au-delà des ressources disponibles, les émissions, en dépit de mille proclamations, évoluent selon le pire des scénarios, comme cela se passe actuellement, et le changement climatique s’accélère jusqu’à produire une apocalypse écologique.
Entre les deux scénarios, il y a des variations infinies, et il est vrai que, au cours de l’histoire, l’Homme a été souvent capable de trouver des solutions inattendues à des problèmes qui semblaient insolubles. Pour revenir à l’année sans été, parmi les enfants qui souffrirent de la disette en Europe, il y avait un certain Justus von Liebig qui, peut-être à cause de cette expérience vécue, décida de se consacrer à la chimie, jetant ainsi les bases pour les fertilisants modernes, sans lesquels on ne pourrait aujourd’hui produire assez de nourriture pour satisfaire la population mondiale. En d’autres termes, personne n’est véritablement en mesure de dire quelle voie empruntera la civilisation humaine, encore que la prudence suggère de prendre très au sérieux l’avertissement que nous donne la réalité. En tout état de cause, même dans l’hypothèse d’un réchauffement mitigé, l’érosion des ressources en cours au Moyen-Orient ou au Sahel laisse prévoir avec une quasi-certitude un avenir de tensions croissantes. Les flux migratoires vont s’intensifier, la chasse aux matières premières va devenir impitoyable, les formes de la civilisation et de la socialisation vont se modifier.
Dans ce contexte, il sera plus que jamais nécessaire d’agir pour alléger les tensions, maintenir la lucidité, prendre les mesures les plus adéquates, défendre l’état de droit contre une logique de l’urgence sécuritaire. Une amitié civique islamo-chrétienne – et ici, je passe à la deuxième partie – sera essentielle pour critiquer le modèle existant et ses prémisses, pour en atténuer les effets, pour secourir les victimes, et surtout pour penser une alternative.
Le risque en cela est de céder à des pulsions antimodernes qui ne seraient d’aucun secours pour résoudre le problème. En d’autres termes, au niveau actuel de la population mondiale, un retour au monde « d’avant les machines » n’aurait pas l’effet utopique de nous restituer à un environnement incontaminé, mais de nous condamner à mourir de faim. Il est clair qu’une bonne partie du problème tourne autour de la possibilité de produire de l’énergie non polluante. Et sur ce point, la confusion règne, souveraine.
À titre d’exemple, le nouveau mantra des automobiles électriques ne comporte aucun bénéfice de fond, si l’électricité est produite en brûlant du charbon. Il déplace seulement le problème, en l’empirant. Plutôt que les actuelles énergies renouvelables, qui pourront difficilement couvrir tous les besoins énergétiques, le pari sur la longue période semble concerner la fusion nucléaire. Une révolution dans ce domaine rendrait d’un seul coup obsolètes les formes d’énergie actuelles. Pour un pays comme l’Italie, pauvre en matières premières et qui n’a par conséquent rien à perdre, ce devrait être la priorité absolue sur laquelle concentrer la recherche.
Mais le scénario optimiste de l’énergie propre n’est pas le seul. Il y en a un autre : le rythme des innovations technologiques ne permet pas un accès immédiat à de nouvelles formes d’énergie. Le système économique se modifie trop lentement, du fait de l’incapacité des individus et des États à faire passer le bien universel avant leur propre intérêt immédiat ; du fait, aussi, de la difficulté, y compris psychologique et cognitive, à penser des problèmes complexes comme le changement climatique, et à modifier en conséquence ses propres habitudes, surtout quand elles semblent encore soutenables. La croissance démographique continue bien au-delà des ressources disponibles, les émissions, en dépit de mille proclamations, évoluent selon le pire des scénarios, comme cela se passe actuellement, et le changement climatique s’accélère jusqu’à produire une apocalypse écologique.
Entre les deux scénarios, il y a des variations infinies, et il est vrai que, au cours de l’histoire, l’Homme a été souvent capable de trouver des solutions inattendues à des problèmes qui semblaient insolubles. Pour revenir à l’année sans été, parmi les enfants qui souffrirent de la disette en Europe, il y avait un certain Justus von Liebig qui, peut-être à cause de cette expérience vécue, décida de se consacrer à la chimie, jetant ainsi les bases pour les fertilisants modernes, sans lesquels on ne pourrait aujourd’hui produire assez de nourriture pour satisfaire la population mondiale. En d’autres termes, personne n’est véritablement en mesure de dire quelle voie empruntera la civilisation humaine, encore que la prudence suggère de prendre très au sérieux l’avertissement que nous donne la réalité. En tout état de cause, même dans l’hypothèse d’un réchauffement mitigé, l’érosion des ressources en cours au Moyen-Orient ou au Sahel laisse prévoir avec une quasi-certitude un avenir de tensions croissantes. Les flux migratoires vont s’intensifier, la chasse aux matières premières va devenir impitoyable, les formes de la civilisation et de la socialisation vont se modifier.
Dans ce contexte, il sera plus que jamais nécessaire d’agir pour alléger les tensions, maintenir la lucidité, prendre les mesures les plus adéquates, défendre l’état de droit contre une logique de l’urgence sécuritaire. Une amitié civique islamo-chrétienne – et ici, je passe à la deuxième partie – sera essentielle pour critiquer le modèle existant et ses prémisses, pour en atténuer les effets, pour secourir les victimes, et surtout pour penser une alternative.
II. L’écologie comme chantier islamo-chrétien
1. Assumer de façon critique la pensée écologiste
Dans la crise écologique, du reste, il y a en jeu plus que la restructuration des rapports de production et consommation ou des modèles de développement technologique. Le fond du problème est d’ordre anthropologique, parce que « il n’y a pas d’écologie sans une anthropologie adéquate » (Laudato Si’, n. 118). Le lien est très étroit.
Lire aussi : Ecologie, les leçons au monde à retenir du pape François
Une preuve a contrario nous est offerte – me semble-t-il – par l’inflexion singulière qui s’est introduite dans la culture européenne dominante, par effet de la crise écologique et des migrations. Du nihilisme joyeux diagnostiqué par Augusto Del Noce, que la chute du mur de Berlin semblait avoir consacré définitivement, on est passé insensiblement à un nihilisme furieux et désespéré. Beaucoup cherchent à s’agripper de toutes leurs forces à leur part de bien-être personnel, en étant bien conscient que ce n’est pas pour tous et ne durera pas toujours. Il y a certes des exceptions, mais l’on respire une atmosphère fin de siècle ou, si l’on préfère la Bible, des derniers jours de Samarie. Nous voulons l’appeler populisme ? Uniquement si cela ne devient pas une excuse pour ne pas l’étudier, pour éviter de comprendre d’où il est né, d’où il vient. Et il vient de loin. De bien plus loin que le Papeete. (10)
Au fond, ce populisme repose fondamentalement sur l’affirmation de la disponibilité totale du réel au pouvoir de l’homme de le façonner à son gré. (11) En bonne logique, il faudrait tirer de la crise écologique la conclusion que l’idée de l’infinie expérimentation du réel de la part du sujet humain est tout simplement erronée. Il y a des limites, il y a des biens non disponibles. C’est ce que signifie, au fond, le slogan « nous n’avons pas de planète B ». En ce sens, il me semble qu’il faille récupérer les critiques au mythe d’un progrès capable d’autorégulation formulées par Romano Guardini dans La Fin des temps modernes : comme l’homme n’a pas encore de « pouvoir sur son propre pouvoir » – écrit Guardini dans ce texte à bien des égards prophétique – « il vivra, désormais et à jamais (…) au bord d’un danger qui menace toute son existence et qui croît continuellement ». (12)
Or, il serait sans aucun doute hautement souhaitable que le concept de biens non disponibles soit étendu au-delà de la seule catégorie d’environnement, pour inclure aussi les thèmes du début et de la fin de la vie ou de la manipulation génétique, également dans une perspective de critique de la marchandisation. Mais on peut se douter que beaucoup de militants écologistes soient disposés à franchir ce pas, ne serait-ce que parce que cela signifierait reconnaître que la pensée progressiste, dans sa version libéral, partage avec les populistes abhorrés beaucoup plus qu’on est disposé à admettre. En fait, l’anthropologie dont les deux mouvements se réclament présente plus d’une ressemblance, même si d’un côté elle est déclinée comme fermeture dans un club all exclusive (en ce sens que tous les non-membres en restent au-dehors), tandis que de l’autre elle s’ouvre à une célébration des infinies diversités possibles.
Plutôt qu’à une conversion anthropologique de cette portée, il est plus probable qu’il faille s’attendre à une utilisation de la thématique de l’environnement pour conférer une nouvelle vigueur à un universalisme abstrait, afin de rassembler des individus qui resterait autrement enfermés dans des cercles autoréférentiels. (13) Même cette seconde hypothèse, dont on décèle peut-être les prodromes dans les mouvements de ces derniers mois, représente de toutes façons une injection salutaire de réalisme par rapport à la « dictature du désir » que stigmatisait Benoît XVI. « Tu peux choisir qui tu veux être, mais à condition de ne pas émettre trop d’anhydride carbonique » est un message contradictoire, mais de toutes façons meilleur que « il n’y a pas de limite à l’expérimentation » – l’expérimentation que tu crois exercer, et celle qu’en réalité le pouvoir exerce sur toi et en toi.
Ce serait faire preuve d’ingénuité que de se cacher les côtés obscurs du mouvement écologiste : le panthéisme de la « mère nature » qui a trouvé malheureusement plusieurs échos jusque dans les milieux ecclésiastiques, les slogans antihumanistes comme « l’homme est le pire parasite de la planète », le « plus je connais les hommes, plus j’aime les animaux », en somme, la nécessité de s’auto-éliminer poliment de l’histoire. La décroissance heureuse n’est après tout pas si heureuse, et les sociétés habitées de seuls vieux et de vieux seuls, comme l’Italie s’en approche à pas rapides, ne sont pas meilleures que celles qui souffrent d’un excès de naissances. Mais le fait qu’une partie du discours écologiste ne soit pas acceptable et qu’il existe, comme dans toutes les réalités humaines, des éléments obscurs et des intérêts non déclarés n’est pas une raison suffisante pour liquider le problème écologique comme inexistant. Notamment parce qu’il y a tout autant d’éléments obscurs et d’intérêts non déclarés qui militent pour un scénario business as usual.
Lire aussi : Ecologie, les leçons au monde à retenir du pape François
Une preuve a contrario nous est offerte – me semble-t-il – par l’inflexion singulière qui s’est introduite dans la culture européenne dominante, par effet de la crise écologique et des migrations. Du nihilisme joyeux diagnostiqué par Augusto Del Noce, que la chute du mur de Berlin semblait avoir consacré définitivement, on est passé insensiblement à un nihilisme furieux et désespéré. Beaucoup cherchent à s’agripper de toutes leurs forces à leur part de bien-être personnel, en étant bien conscient que ce n’est pas pour tous et ne durera pas toujours. Il y a certes des exceptions, mais l’on respire une atmosphère fin de siècle ou, si l’on préfère la Bible, des derniers jours de Samarie. Nous voulons l’appeler populisme ? Uniquement si cela ne devient pas une excuse pour ne pas l’étudier, pour éviter de comprendre d’où il est né, d’où il vient. Et il vient de loin. De bien plus loin que le Papeete. (10)
Au fond, ce populisme repose fondamentalement sur l’affirmation de la disponibilité totale du réel au pouvoir de l’homme de le façonner à son gré. (11) En bonne logique, il faudrait tirer de la crise écologique la conclusion que l’idée de l’infinie expérimentation du réel de la part du sujet humain est tout simplement erronée. Il y a des limites, il y a des biens non disponibles. C’est ce que signifie, au fond, le slogan « nous n’avons pas de planète B ». En ce sens, il me semble qu’il faille récupérer les critiques au mythe d’un progrès capable d’autorégulation formulées par Romano Guardini dans La Fin des temps modernes : comme l’homme n’a pas encore de « pouvoir sur son propre pouvoir » – écrit Guardini dans ce texte à bien des égards prophétique – « il vivra, désormais et à jamais (…) au bord d’un danger qui menace toute son existence et qui croît continuellement ». (12)
Or, il serait sans aucun doute hautement souhaitable que le concept de biens non disponibles soit étendu au-delà de la seule catégorie d’environnement, pour inclure aussi les thèmes du début et de la fin de la vie ou de la manipulation génétique, également dans une perspective de critique de la marchandisation. Mais on peut se douter que beaucoup de militants écologistes soient disposés à franchir ce pas, ne serait-ce que parce que cela signifierait reconnaître que la pensée progressiste, dans sa version libéral, partage avec les populistes abhorrés beaucoup plus qu’on est disposé à admettre. En fait, l’anthropologie dont les deux mouvements se réclament présente plus d’une ressemblance, même si d’un côté elle est déclinée comme fermeture dans un club all exclusive (en ce sens que tous les non-membres en restent au-dehors), tandis que de l’autre elle s’ouvre à une célébration des infinies diversités possibles.
Plutôt qu’à une conversion anthropologique de cette portée, il est plus probable qu’il faille s’attendre à une utilisation de la thématique de l’environnement pour conférer une nouvelle vigueur à un universalisme abstrait, afin de rassembler des individus qui resterait autrement enfermés dans des cercles autoréférentiels. (13) Même cette seconde hypothèse, dont on décèle peut-être les prodromes dans les mouvements de ces derniers mois, représente de toutes façons une injection salutaire de réalisme par rapport à la « dictature du désir » que stigmatisait Benoît XVI. « Tu peux choisir qui tu veux être, mais à condition de ne pas émettre trop d’anhydride carbonique » est un message contradictoire, mais de toutes façons meilleur que « il n’y a pas de limite à l’expérimentation » – l’expérimentation que tu crois exercer, et celle qu’en réalité le pouvoir exerce sur toi et en toi.
Ce serait faire preuve d’ingénuité que de se cacher les côtés obscurs du mouvement écologiste : le panthéisme de la « mère nature » qui a trouvé malheureusement plusieurs échos jusque dans les milieux ecclésiastiques, les slogans antihumanistes comme « l’homme est le pire parasite de la planète », le « plus je connais les hommes, plus j’aime les animaux », en somme, la nécessité de s’auto-éliminer poliment de l’histoire. La décroissance heureuse n’est après tout pas si heureuse, et les sociétés habitées de seuls vieux et de vieux seuls, comme l’Italie s’en approche à pas rapides, ne sont pas meilleures que celles qui souffrent d’un excès de naissances. Mais le fait qu’une partie du discours écologiste ne soit pas acceptable et qu’il existe, comme dans toutes les réalités humaines, des éléments obscurs et des intérêts non déclarés n’est pas une raison suffisante pour liquider le problème écologique comme inexistant. Notamment parce qu’il y a tout autant d’éléments obscurs et d’intérêts non déclarés qui militent pour un scénario business as usual.
2. Le point de départ et le point d’arrivée
Dans la tâche ardue d’assumer critiquement la pensée écologiste, la pensée chrétienne peut trouver une aide significative – et c’est là la dernière thèse que je voudrais développer – dans l’interaction dialogique avec le monde musulman. Il ne s’agit pas seulement de partager un engagement social au niveau des implications de la foi (14), à partir du fait, très concret, que chrétiens et musulmans constituent aujourd’hui, dans leur ensemble, plus de la moitié de la population mondiale. Par-delà de l’amitié civique évoquée plus haut, il est possible de pousser la réflexion jusqu’au plan proprement théologique. Deux catégories me semblent en cela particulièrement fécondes : création et eschatologie.
Les deux plus grandes communautés religieuses mondiales partagent en effet, avec les juifs, la vision du commencement et de la fin, du maʾāl et du maʿād (15) : au commencement, la création. À la fin, le jugement et l’eschatologie. Au milieu, c’est là qu’est la différence, comme nous le savons bien.
Les deux plus grandes communautés religieuses mondiales partagent en effet, avec les juifs, la vision du commencement et de la fin, du maʾāl et du maʿād (15) : au commencement, la création. À la fin, le jugement et l’eschatologie. Au milieu, c’est là qu’est la différence, comme nous le savons bien.
Dans le contexte de la crise écologique, la catégorie de création devra probablement faire l’objet d’une nouvelle réflexion islamo-chrétienne, développée idéalement en dialogue avec les découvertes surprenantes de la physique contemporaine, tout dans le respect des méthodes et domaines différents. (16) À ce propos, il est intéressant de récupérer ce qu’affirmait saint Jean-Paul II, qui pourtant n’était certes pas tendre envers les pointes extrêmes de la pensée écologiste, dans l’encyclique Centesimus annus (n. 37) :
« L’homme, qui découvre sa capacité de transformer et, en un certain sens, de créer le monde par son propre travail, oublie que cela s’accomplit toujours à partir du premier don originel des choses fait par Dieu. Il croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre, en la soumettant sans mesure à sa volonté, comme si elle n’avait pas une forme et une destination antérieures que Dieu lui a données, que l’homme peut développer, mais qu’il ne doit pas trahir. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se substitue à Dieu et finit, ainsi, par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. »
La théologie musulmane, sur ce point, ne dit rien d’autre. (17)
Plus précisément, la catégorie de création se révèle fondamentale pour ne faire pas basculer l’écologisme en un mouvement antihumaniste. Dans le même temps, le soin avec qui l’islam, dans ses versions orthodoxes, veille à maintenir intacte la distance entre Dieu et le monde, constitue un grand rappel pour la pensée chrétienne : en aucun moment la défense du créé ne devrait assumer la forme d’un immanentisme panthéiste. Le monothéisme intransigeant de l’islam, qui, pour moi, chrétien, trouve son fondement le plus sûr dans le dogme trinitaire (si stupéfiant que cela puisse paraître), ne peut être contourné sur ce point, au risque de se placer en-dehors de l’univers biblique.
Tout aussi importante se révèle l’eschatologie. Pratiquement disparue aujourd’hui de la pensée chrétienne, elle a été liquidée avec la trop rapide explication des « genres littéraires » qui, dans la version de l’homélie dominicale, se résume à la thèse suivante : Jésus, voulant enseigner une chose, serait resté prisonnier des formes littéraires de son temps, finissant par dire exactement le contraire. En d’autres termes, le Rabbi de Galilée aurait été tout autant anticonformiste dans son comportement qu’incapable d’innover au niveau des mots et des images. Peu crédible.
Quand l’eschatologie sort de la scène, sa place ne reste pas vide, mais est occupée par une de ses versions dégradées, le millénarisme, dans la version criminelle et exaltée à l’État Islamique, ou par un nihilisme décliniste. Son trait distinctif est l’angoisse. Par contre, la foi en un Dieu personnel, à la fois juste et miséricordieux, donne aux chrétiens et aux musulmans, tout comme à l’Israël de Dieu qui l’a le premier exprimée, cette forte assurance existentielle dont on a absolument besoin pour affronter sans hystérisme et sans négationnisme la crise écologique. Grâce à Dieu, le dernier mot ne sera pas le nôtre. Le bēt sur lequel s’ouvre le livre de la Genèse dans la Bible hébraïque est aussi la demeure (bēt justement) « de Dieu avec les hommes » (Ap 21,3) à la fin des temps, « un ciel nouveau et une terre nouvelle, parce que le ciel et la terre d’avant avaient disparu et la mer n’était plus » (Ap 21,1). Sans cette perspective, qui lit les tribulations de la création – des faits réels, non des métaphores littéraires – comme « les douleurs de l’enfantement » (Rm 8,19), le risque de s’abandonner à un pessimisme apocalyptique est grand et quasi inévitable : il paralyserait les capacités d’agir de l’homme.
Le christianisme, avec sa foi inaliénable en l’homme-Dieu, se situe pour ainsi dire à mi-chemin entre un anthropocentrisme immanent et un théisme tenté par le monisme, et d’aucuns ont voulu indiquer dans la formule du et et le génie du catholicisme. Trop souvent, à l’époque moderne, celle-ci a été déclinée plutôt comme un versus – versus dans lequel la voie étroite de l’Évangile a été définie uniquement par contraste. La crise écologique pourrait offrir l’occasion d’un changement de paradigme, où l’on puisse distinguer ce qu’il y a de bon dans l’instance écologiste, sans renoncer pour autant à une nette orientation transcendante. Et et. Nous pourrions nous retrouver avec des compagnons de route inattendus.
(1) Alister Doyle, Evidence for man-made global warming hits ‘gold standard’: scientists, Reuters, 25 février 2019. Lien.
(2) Peter Harling, Nature’s Insurgency. Water Wanted in the land of Plenty, septembre 2019. Lien. Traduction française abrégée : L’Irak assoiffé par la folie humaine, Orient XXI, septembre 2019.
(3) Nature’s Insurgency, p. 9
(4) Nature’s Insurgency, p. 11
(5) Alexander Jusdanis, The Making of a Water Crisis, Dissent, 1 août 2018. Lien.
(6) Hamza Hamouchene, The Ouarzazate Solar Plant in Morocco: Triumphal ‘Green’ Capitalism and the Privatization of Nature, Jadaliyya, 23 mars 2016. Lien
(7) Riccardo Piol, L’armée d’immigrés qui va à la Messe et élève des gratte-ciels, Oasis 11 (2010), pp. 81-85.
(8) Nicola Di Cosmo, The Scientist as Antiquarian: History, Climate and the New Past, The Institute Letter, Spring 2018. Lien
(9) John Post, The Last Great Subsistence Crisis in the Western World, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1977
(10) Le Papeete est le beach club proche de Rimini où Matteo Salvini, le secrétaire de la Ligue, a passé ses vacations d’été en 2019 et d’où il a décidé d’ouvrir la crise de gouvernement.
(11) C’est l’intuition de Benoît XVI dans son discours au Parlement allemand du 22 septembre 2011. Ici.
(12) Romano Guardini, La fine dell’ epoca moderna. Il potere, Morcelliana, Brescia 1954, p. 88 (éd. française : La fin des temps modernes, Seuil, Paris 1950).
(13) Sur la dialectique entre universalisme et particularisme, voir Francesco Botturi, Universale, plurale, comune. Percorsi di filosofia sociale, Vita e Pensiero, Milano 2018 et Idem, Les conditions de la coexistence multiculturelle, Oasis n. 28 (2018), pp. 96-107
(14) Cfr. Angelo Scola, Buone ragioni per la vita in comune, Mondadori, Milano 2010
(15) Cfr. Khaled al-Jaber, L’homme salit la pureté des religions, Oasis n. 8 (2008), pp. 43-47
(16) C’est toute la thématique de l’homme « calife » de Dieu (développée à partir de Coran 2,30), et de la « soumission » de la nature à l’homme (Coran, 43,13)
Lire aussi : Vidéo – La Casa del Hikma : le califat, un régime théocratique ?
*****
Docteur en études orientales à l’Université Ca' Foscari de Venise, Martino Diez est directeur scientifique de la Fondation internationale Oasis et enseignant-chercheur en langue et littérature arabe à l'Université catholique de Milan. Première parution de l’article dans son intégralité dans Oasis le 10 janvier 2020.
Lire aussi :
Biodiversité : la sixième extinction de masse en marche, de l'urgence de renverser la vapeur
« L’homme, qui découvre sa capacité de transformer et, en un certain sens, de créer le monde par son propre travail, oublie que cela s’accomplit toujours à partir du premier don originel des choses fait par Dieu. Il croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre, en la soumettant sans mesure à sa volonté, comme si elle n’avait pas une forme et une destination antérieures que Dieu lui a données, que l’homme peut développer, mais qu’il ne doit pas trahir. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l’œuvre de la création, l’homme se substitue à Dieu et finit, ainsi, par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. »
La théologie musulmane, sur ce point, ne dit rien d’autre. (17)
Plus précisément, la catégorie de création se révèle fondamentale pour ne faire pas basculer l’écologisme en un mouvement antihumaniste. Dans le même temps, le soin avec qui l’islam, dans ses versions orthodoxes, veille à maintenir intacte la distance entre Dieu et le monde, constitue un grand rappel pour la pensée chrétienne : en aucun moment la défense du créé ne devrait assumer la forme d’un immanentisme panthéiste. Le monothéisme intransigeant de l’islam, qui, pour moi, chrétien, trouve son fondement le plus sûr dans le dogme trinitaire (si stupéfiant que cela puisse paraître), ne peut être contourné sur ce point, au risque de se placer en-dehors de l’univers biblique.
Tout aussi importante se révèle l’eschatologie. Pratiquement disparue aujourd’hui de la pensée chrétienne, elle a été liquidée avec la trop rapide explication des « genres littéraires » qui, dans la version de l’homélie dominicale, se résume à la thèse suivante : Jésus, voulant enseigner une chose, serait resté prisonnier des formes littéraires de son temps, finissant par dire exactement le contraire. En d’autres termes, le Rabbi de Galilée aurait été tout autant anticonformiste dans son comportement qu’incapable d’innover au niveau des mots et des images. Peu crédible.
Quand l’eschatologie sort de la scène, sa place ne reste pas vide, mais est occupée par une de ses versions dégradées, le millénarisme, dans la version criminelle et exaltée à l’État Islamique, ou par un nihilisme décliniste. Son trait distinctif est l’angoisse. Par contre, la foi en un Dieu personnel, à la fois juste et miséricordieux, donne aux chrétiens et aux musulmans, tout comme à l’Israël de Dieu qui l’a le premier exprimée, cette forte assurance existentielle dont on a absolument besoin pour affronter sans hystérisme et sans négationnisme la crise écologique. Grâce à Dieu, le dernier mot ne sera pas le nôtre. Le bēt sur lequel s’ouvre le livre de la Genèse dans la Bible hébraïque est aussi la demeure (bēt justement) « de Dieu avec les hommes » (Ap 21,3) à la fin des temps, « un ciel nouveau et une terre nouvelle, parce que le ciel et la terre d’avant avaient disparu et la mer n’était plus » (Ap 21,1). Sans cette perspective, qui lit les tribulations de la création – des faits réels, non des métaphores littéraires – comme « les douleurs de l’enfantement » (Rm 8,19), le risque de s’abandonner à un pessimisme apocalyptique est grand et quasi inévitable : il paralyserait les capacités d’agir de l’homme.
Le christianisme, avec sa foi inaliénable en l’homme-Dieu, se situe pour ainsi dire à mi-chemin entre un anthropocentrisme immanent et un théisme tenté par le monisme, et d’aucuns ont voulu indiquer dans la formule du et et le génie du catholicisme. Trop souvent, à l’époque moderne, celle-ci a été déclinée plutôt comme un versus – versus dans lequel la voie étroite de l’Évangile a été définie uniquement par contraste. La crise écologique pourrait offrir l’occasion d’un changement de paradigme, où l’on puisse distinguer ce qu’il y a de bon dans l’instance écologiste, sans renoncer pour autant à une nette orientation transcendante. Et et. Nous pourrions nous retrouver avec des compagnons de route inattendus.
(1) Alister Doyle, Evidence for man-made global warming hits ‘gold standard’: scientists, Reuters, 25 février 2019. Lien.
(2) Peter Harling, Nature’s Insurgency. Water Wanted in the land of Plenty, septembre 2019. Lien. Traduction française abrégée : L’Irak assoiffé par la folie humaine, Orient XXI, septembre 2019.
(3) Nature’s Insurgency, p. 9
(4) Nature’s Insurgency, p. 11
(5) Alexander Jusdanis, The Making of a Water Crisis, Dissent, 1 août 2018. Lien.
(6) Hamza Hamouchene, The Ouarzazate Solar Plant in Morocco: Triumphal ‘Green’ Capitalism and the Privatization of Nature, Jadaliyya, 23 mars 2016. Lien
(7) Riccardo Piol, L’armée d’immigrés qui va à la Messe et élève des gratte-ciels, Oasis 11 (2010), pp. 81-85.
(8) Nicola Di Cosmo, The Scientist as Antiquarian: History, Climate and the New Past, The Institute Letter, Spring 2018. Lien
(9) John Post, The Last Great Subsistence Crisis in the Western World, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1977
(10) Le Papeete est le beach club proche de Rimini où Matteo Salvini, le secrétaire de la Ligue, a passé ses vacations d’été en 2019 et d’où il a décidé d’ouvrir la crise de gouvernement.
(11) C’est l’intuition de Benoît XVI dans son discours au Parlement allemand du 22 septembre 2011. Ici.
(12) Romano Guardini, La fine dell’ epoca moderna. Il potere, Morcelliana, Brescia 1954, p. 88 (éd. française : La fin des temps modernes, Seuil, Paris 1950).
(13) Sur la dialectique entre universalisme et particularisme, voir Francesco Botturi, Universale, plurale, comune. Percorsi di filosofia sociale, Vita e Pensiero, Milano 2018 et Idem, Les conditions de la coexistence multiculturelle, Oasis n. 28 (2018), pp. 96-107
(14) Cfr. Angelo Scola, Buone ragioni per la vita in comune, Mondadori, Milano 2010
(15) Cfr. Khaled al-Jaber, L’homme salit la pureté des religions, Oasis n. 8 (2008), pp. 43-47
(16) C’est toute la thématique de l’homme « calife » de Dieu (développée à partir de Coran 2,30), et de la « soumission » de la nature à l’homme (Coran, 43,13)
Lire aussi : Vidéo – La Casa del Hikma : le califat, un régime théocratique ?
*****
Docteur en études orientales à l’Université Ca' Foscari de Venise, Martino Diez est directeur scientifique de la Fondation internationale Oasis et enseignant-chercheur en langue et littérature arabe à l'Université catholique de Milan. Première parution de l’article dans son intégralité dans Oasis le 10 janvier 2020.
Lire aussi :
Biodiversité : la sixième extinction de masse en marche, de l'urgence de renverser la vapeur











 Sur le vif
Sur le vif

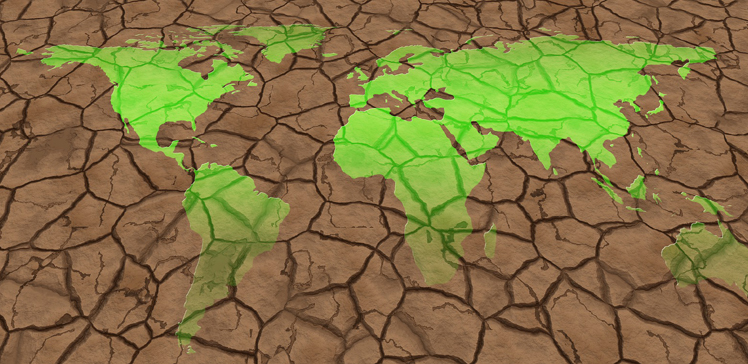






















 Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ?